Par Haas Avocats
La clause pénale est l'une des stipulations contractuelles les plus courantes. Son objectif principal est de déterminer par avance le montant des dommages-intérêts dû par l'une des parties en cas d'inexécution de ses obligations. Elle joue ainsi un double rôle : inciter le débiteur à exécuter ses engagements et prévoir une réparation forfaitaire du préjudice.
Le pouvoir du juge de modérer une clause pénale
Lorsqu'un contrat prévoit une clause pénale, celle-ci a pour objet de déterminer par avance le montant de l'indemnisation due en cas de non-respect des engagements contractuels.
Cependant, cette clause ne peut pas conduire à des sanctions manifestement excessives. C'est dans ce cadre que le juge dispose d'un pouvoir d'intervention pour réduire son montant si elle excède le préjudice effectivement subi par le créancier.
|
Nota : Conditions de mise en œuvre de la clause pénale au sens de l’article 1231 et suivants du Code civil
|
L'article 1231-5 du Code civil confère ainsi au juge le pouvoir de modérer une clause pénale jugée excessivement lourde ou dérisoire. L'objectif est d'éviter qu'une partie ne soit injustement sanctionnée au-delà du préjudice subi par le créancier.
Un équilibre entre respect du contrat et protection contre les abus
La jurisprudence encadre strictement la réduction des clauses pénales afin de garantir un équilibre entre le respect du contrat et la prévention des abus.
Si une clause pénale est excessive, le juge peut en modérer le montant, mais uniquement lorsqu’elle est manifestement disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi par le créancier[1]. Il ne peut en aucun cas l’abaisser en dessous du dommage subi, ce qui permet d’éviter que cette modulation ne devienne un outil d’évitement des obligations contractuelles.
L’arrêt du 11 décembre 2024[2] illustre cette exigence en rappelant que toute réduction doit être justifiée par une analyse concrète du préjudice. Un montant élevé ou un déséquilibre apparent ne suffisent pas : la disproportion doit être avérée. De manière générale, il a déjà été jugé que le juge ne peut se fonder que sur cette disproportion et non sur le fait que la pénalité procure au créancier un bénéfice supérieur à celui qu’il aurait retiré de l’exécution normale de la convention[3] ou qu’elle serait manifestement excessive au regard des prestations fournies[4].
Cette approche vise à protéger les débiteurs contre des clauses abusives, particulièrement dans les contrats de prêt ou les relations commerciales, où elles peuvent être fixées à des niveaux excessifs et avoir un effet dissuasif injustifié.
Cependant, cette protection ne doit pas aller au détriment des créanciers, qui ont droit à une indemnisation proportionnée au préjudice subi. Les juges veillent ainsi à ce que la réduction des clauses pénales ne soit pas utilisée de manière abusive pour permettre aux débiteurs d’échapper à leurs engagements.
En pratique, toute contestation d’une clause pénale nécessite une démonstration rigoureuse de cette disproportion entre le montant prévu et le préjudice réel.
***
Que vous souhaitiez contester une clause pénale excessive ou au contraire défendre fermement votre droit à indemnisation, il conviendra toujours d’être en mesure de démontrer l’adéquation (ou non) de la clause par rapport au préjudice allégué.
***
Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis plus de vingt-cinq ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne de nombreux acteurs du numérique dans le cadre de leurs problématiques judiciaires et extrajudiciaires relatives au droit commercial. Dans un monde incertain, choisissez de vous faire accompagner par un cabinet d’avocats fiables. Pour nous contacter, cliquez ici.
[1] Cass. com. 11 févr. 1997 n° 95-10.851 P-B: RJDA 5/97 no 610
[2] Cass. com. 11 déc. 2024, n° 23-15.744
[3] Cass. com. 14 déc. 2010 n° 09-68.275 F-D
[4] Cass. com. 16 févr 2010 n° 09-13.380 F-D: RJDA 5/10 no 472




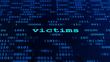
.png?width=110&name=Comment%20se%20pr%C3%A9parer%20%C3%A0%20l%E2%80%99assurance%20cyber%20conditionn%C3%A9e%20%C3%A0%20une%20plainte%20sous%2072h%20%20(1).png)